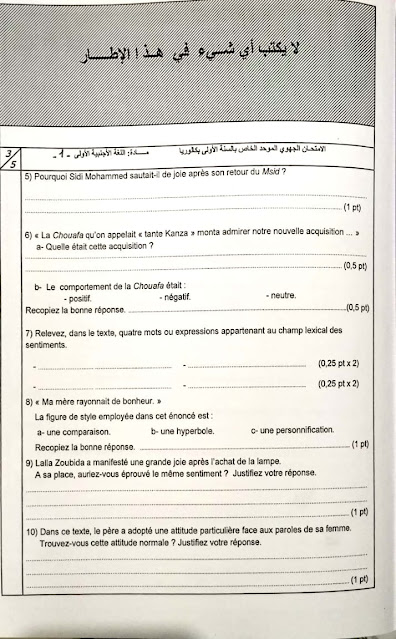Figures de style
Les figures de style sont des procédés qui visent à rendre un énoncé plus expressif.
A. Les figures de rapprochement :
Exemple
: « Son sourire est pareil à l'éclat du soleil ».
2. La métaphore : comme la comparaison, elle
rapproche deux éléments, mais sans les relier
par un outil de comparaison.
Exemple
: « La vie est un long fleuve tranquille ».
3. 3. La personnification : c’est la représentation d’une chose ou d’un animal sous une forme
humaine.
Exemple : « Le vent mugissait dans les branches
et hurlait sous les portes
».
B. Les figures de remplacement :
1.
La métonymie
: cette figure consiste à désigner un être ou un objet par un autre être ou objet qui a un rapport avec lui.
Exemple : « boire un verre » (le contenant désigne le contenu).
« Tout Paris accourut ». (Lenom de la ville désigne
l’ensemble des habitants).
2.
La périphrase : on emploie une expression
au lieu d’un seul mot pour
désigner un être ou un
objet.
Exemple : « la ville rouge»
pour Marrakech.
3. La Synecdoque
: Elle
consiste à une désigner une chose, un objet ou une personne par une partie
(la partie pour le tout).
Exemple : une Foule de têtes se dirige vers le terrain.
4. 4- L’euphémisme : on emploie à la place d’un mot, jugé brutal, un autre mot, au sens atténué.
Exemple : « Il n’est plus tout jeune » = il est vieux.
C. Les figures d'insistance :
1- L’anaphore
: on répète un mot ou une expression au début de plusieurs vers ou phrases.
Exemple : « Que tu es belle, ma bien aimée, Que tu es belle! Cantique
des Cantiques »
2- L’hyperbole : on emploie
des termes exagérés
pour frapper l’imagination du destinataire. Exemple
: « être mort de rire ».
3-
La gradation :
on fait se
suivre dans une même phrase ou un même vers des termes de plus en plus forts.
Exemple : « Va, cours,
vole et nous venge!
»
4-
L’énumération : Succession de termes ou de groupes
de mots qui donne une impression de quantité ou de grandeur.
Exemple : « Adieu veaux,
vaches, cochons, couvées
».
D. Les figures d'opposition :
1.
L’oxymore : on rapproche deux termes de sens contradictoires dans un
même groupe de mots.
Exemple : « Cette obscure
clarté qui tombe des étoiles
».
2. L’antithèse : on rapproche dans une même
phrase deux idées opposées. Exemple : « N’est-ce
pas toi qui pleures et Méduse qui rit ? »
3. L’antiphrase : C’est le fait d’exprimer le contraire de ce que l’on pense, sans laisser
aucun doute sur sa véritable opinion.
Exemple : « Ah ! C’est du joli ! C’est du propre ! Toi, la fille d'un roi ! »
Identifie les figures de style dans les phrases suivantes. :
1-"Elle est toujours là cette pensée
infernale, comme un spectre de plomb."
2. -"J’en
suis resté navré, glacé, anéanti."
3.
-"Et
un moment après, voilà que deux ou trois portes basses vomirent presque en même temps,
dans la cour, des nuées d’hommes….C’était les prisonniers".
4.
-"La place est là, l’horrible peuple
qui aboie".
5. -"«
Il va bien ! » a dit une femme….Cet
atroce éloge m’a donné du courage".
6. -"Une
horrible, une sanglante, une implacable idée."
7. -"Je
laisse une mère, je laisse
une femme, je laisse un enfant".
8. -"Le
flot des passants
s’arrêtait pour voir passer la voiture".
9.
-"Ils
furent salués d’acclamations et d’applaudissements qu’ils recevaient avec une
sorte de modestie fière."
10. -"Chaque jour, chaque heure, chaque minute avait son idée".
11. -"Vous serez
seul dans votre
loge comme le roi".
12. -"J’étais demeuré à la fenêtre, immobile,
perclus ; paralysé".
13.
-"Mais
ma fille, mon enfant, ma pauvre petite Marie, qui rit, qui joue, qui chante à
cette heure".
14.
-"Quand
je vis les cinq cordons (les galériens) se ruer vers moi avec des paroles d’une infernale cordialité…"
15.
-"Elle
est toujours là, cette pensée infernale……seule et jalouse, chassant toute distraction, me secouant de ses deux
mains".
16. -"Tout
Bicêtre semblait rire".
17. -"J’étais libre. Maintenant je suis captif".
18. -"J’ai
peut être tort de le repousser ainsi
!c’est lui qui est bon et moi qui suis mauvais !"
19. -"Plutôt mille fois la mort !"
20. -"Au
lieu de remède,
il lui redonnait du poison".